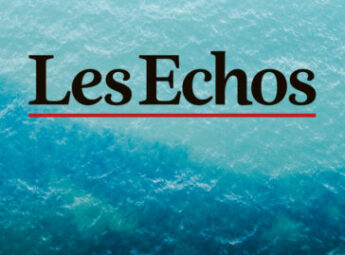L’absentéisme, révélateur et levier de transformation
L’absentéisme au travail est aujourd’hui un enjeu stratégique pour les entreprises françaises, tant il pèse sur leur performance, la qualité des produits et services, et leur attractivité auprès des candidats et des clients. Ce phénomène, qui s’est aggravé depuis la crise du Covid-19, perturbe le fonctionnement quotidien, génère des coûts directs et indirects, dégrade le climat social et peut entraîner un cercle vicieux de démotivation et de turnover au sein des équipes. L’absentéisme est un défi complexe à appréhender : il résulte d’une multitude de facteurs personnels et professionnels, et mobilise de nombreux acteurs dans l’entreprise et son environnement. Il serait plus juste de parler « d’absentéismes » tant les causes, formes et impacts varient selon les contextes et les populations concernées
Un phénomène complexe et évolutif
Depuis la crise du Covid-19, l’absentéisme en France s’est stabilisé à un niveau élevé : en 2024, il dépasse de 41 % le niveau de 2019, principalement du fait de l’augmentation des absences de longue durée (+58 % en cinq ans). La maladie ordinaire reste le premier motif d’arrêt, mais les troubles psychologiques se maintiennent à la deuxième place, touchant particulièrement les jeunes. Les femmes, du fait de la double charge professionnelle et domestique et de leur forte présence dans les secteurs exposés, affichent un taux d’absentéisme supérieur à celui des hommes. Les seniors, de plus en plus nombreux au travail, voient leur taux d’absentéisme augmenter, notamment à cause des arrêts longs liés aux TMS et aux maladies chroniques. Les ouvriers et employés cumulent fréquence et durée d’arrêt, reflet de la pénibilité persistante de leurs métiers, tandis que les cadres et managers sont désormais confrontés à une progression de l’absentéisme liée à la pression managériale et aux risques psychosociaux. Les secteurs soumis à la pénibilité physique, aux horaires décalés, à la répétitivité des gestes ou à l’exposition à des risques professionnels restent les plus touchés.
Les principaux motifs et dynamiques
Les maladies ordinaires et saisonnières représentent plus de 50 % des arrêts, et jusqu’à 70 % des arrêts courts : ces arrêts, très fréquents mais courts, relèvent surtout de la sphère personnelle. Les troubles musculosquelettiques touchent 50 % des travailleurs au cours de leur carrière et représentent 16 % des arrêts courts et longs. Les troubles psychologiques, stress et risques psychosociaux représentent un quart des arrêts longs et sont la première cause d’absentéisme de longue durée, avec une progression marquée chez les jeunes actifs et les cadres. Les conditions de travail difficiles (horaires, équipements, ambiance, manque de flexibilité), la surcharge de travail, la fatigue chronique et le sous-effectif jouent également un rôle central dans la dynamique de l’absentéisme.
Le présentéisme, phénomène souvent sous-estimé, se traduit par la présence au travail de salariés malades ou insuffisamment rétablis, ce qui nuit à la productivité et peut aggraver l’état de santé des salariés concernés. L’absentéisme abusif, quant à lui, bien que minoritaire, fragilise la cohésion des équipes et alimente un climat de défiance. Face à ces défis, l’employeur doit conjuguer vigilance et prévention, sans stigmatiser les salariés réellement malades, afin de préserver l’équilibre et la confiance au sein de l’organisation.
Un impact économique et social majeur
Le coût des indemnités journalières versées par l’Assurance maladie aux salariés du secteur privé a atteint 17 Md€ en 2024, contre 8 Md€ en 2017. Le coût pour les entreprises privées pour assurer le maintien de salaire de leurs salariés en arrêt maladie représente 11,6 Md€ en 2022. Dans le secteur public, le coût des absences pour raison de santé est évalué à 15 Md€. À cela s’ajoutent des coûts indirects : remplacement, baisse de productivité, désorganisation, impact sur l’engagement et le bien-être des équipes. L’absentéisme de longue durée coûte le plus à l’entreprise, entre 55 et 60 % du coût total, même si les arrêts courts sont plus fréquents et plus visibles. De nouvelles règles introduites en 2025 modifient les modalités d’indemnisation dans le public et le privé
Les spécificités françaises et l’importance de la prévention
La France se distingue par une progression de l’absentéisme plus marquée qu’ailleurs en Europe, des arrêts longue durée plus fréquents et un coût global supérieur. Cette situation s’explique par une prévention encore timide, centrée sur la réparation plus que sur l’anticipation, des dispositifs de suivi moins systématiques, un dialogue social parfois en retrait, et une organisation du travail souvent verticale et peu responsabilisante. Les salariés français sont plus nombreux qu’ailleurs à juger leurs conditions de travail difficiles, à travailler sur leur temps libre et à manquer de reconnaissance et d’autonomie.
L’analyse fine des données RH : clé de voûte d’une stratégie efficace
Face à la complexité et à l’hétérogénéité des causes, l’analyse approfondie des données RH s’impose comme un levier incontournable. Les approches uniformes, telles que les campagnes de sensibilisation ou les primes de présence, échouent fréquemment car elles ne tiennent pas compte des spécificités de chaque population. Croiser âge, métier, ancienneté, fréquence et durée des absences, mais aussi événements RH comme les changements de management ou les restructurations, permet de révéler des schémas récurrents et d’identifier les causes profondes, qu’elles soient organisationnelles, managériales ou individuelles. L’essor de l’intelligence artificielle et des outils de data visualisation facilite la détection des signaux faibles, tels que l’augmentation des absences courtes, les retards, le désengagement ou les tensions collectives. Cette démarche analytique permet de hiérarchiser les priorités, d’éviter le gaspillage de ressources sur des plans d’action génériques, et d’impliquer managers, représentants du personnel et salariés dans la co-construction de solutions adaptées à chaque population ou service.
Les leviers d’action : vers une prévention intégrée, ciblée et responsabilisante
La lutte contre l’absentéisme passe par la construction d’une culture de santé et de prévention, inspirée des démarches de sécurité et de qualité totale, mais adaptée à chaque contexte. Il s’agit de faire de la santé au travail un projet d’entreprise visible et partagé à tous les niveaux, de valoriser les comportements responsables, la vigilance collective, la solidarité et l’entraide, d’organiser des campagnes de prévention ciblées sur les risques majeurs et d’analyser régulièrement l’impact des actions engagées pour ajuster la stratégie.
Les démarches industrielles structurées, comme celles menées chez Safran, illustrent l’efficacité d’un pilotage quotidien des absences, mais doivent être adaptées à la taille et à la culture de chaque entreprise. L’essentiel est de responsabiliser l’ensemble des acteurs, de favoriser la remontée des signaux faibles et d’impliquer les équipes dans la recherche de solutions.
L’importance du dialogue social
La prévention de l’absentéisme gagne en efficacité lorsque le dialogue social dépasse les postures binaires. Plutôt que d’opposer systématiquement les causes organisationnelles (portées par les représentants du personnel) et la question de l’engagement des collaborateurs (mise en avant par la direction), il s’agit de partager un diagnostic objectif, de reconnaître la diversité des causes et de co-construire les politiques de prévention. L’implication de toutes les parties prenantes, dans une logique de confiance et de transparence, favorise l’appropriation des dispositifs et permet d’adapter les réponses à la réalité de chaque collectif de travail.
La nécessité de développer une culture de la prévention
- Développer la prévention, point faible du modèle français, (près de la moitié des salariés absents ne bénéficient d’aucune mesure spécifique à leur retour, alors que les entretiens systématiques sont la norme en Allemagne ou aux Pays-Bas) doit être une priorité. Les modèles scandinaves, néerlandais ou allemands démontrent l’efficacité d’une prévention renforcée : visites de pré-reprise, cellules de maintien dans l’emploi, bilans de mi-carrière, adaptation des postes et accompagnement au retour)
- Renforcer la médecine du travail, accroître la pluridisciplinarité, mieux coordonner avec la médecine de ville et systématiser les entretiens de retour et les bilans après arrêts.
- Inscrire la politique de prévention dans une politique de santé globale et une véritable culture de la santé
Les entreprises ont tout intérêt à développer une politique de santé globale, en lien avec les initiatives publiques et les organismes de santé/prévoyance. Cela passe par la promotion d’une véritable culture santé : relais des campagnes de vaccination et de dépistage, organisation de bilans de santé, éducation nutritionnelle, incitation à la pratique du sport, détection précoce des maladies et accompagnement des publics fragiles.
Le rôle central des managers
Face à ces enjeux, il est impératif de former les managers à la détection des signaux faibles et à la gestion proactive des situations à risque est indispensable, de façon à ce qu’ils soient en mesure de mieux gérer les situations complexes, d’utiliser tous les leviers à leurs disposition (accompagnement individuel, adaptation des postes, soutien psychologique, dialogue social), mais aussi de favoriser l’engagement en développant autonomie et responsabilisation des équipes.
Les managers doivent aussi être accompagnés pour préserver leur propre équilibre : accès à des dispositifs de soutien psychologique, temps d’échange entre pairs, formation à la gestion du stress et reconnaissance de leur rôle sont des leviers essentiels pour prévenir leur épuisement et renforcer leur engagement.
Enfin, il est indispensable de développer une vigilance collective, où chaque salarié veille sur lui-même et sur ses collègues, afin de détecter plus tôt les signaux faibles de mal-être ou de fatigue et d’agir avant que les situations ne se dégradent, avec l’appui, comme l’ont fait certaines entreprises, de salariés spécifiquement formés à cet effet. Cette attention mutuelle renforce la confiance au sein des équipes et contribue à un climat de travail plus serein et plus réactif face aux imprévus.
Des tendances de fond qui vont continuer à mettre le sujet de l’absentéisme au cœur des enjeux des entreprises :
- Le vieillissement de la population active française, conjugué à une stagnation de l’espérance de vie en bonne santé, au recul de l’âge de la retraite, et à l’exposition aux arrêts de longue durée (TMS, maladies chroniques…) bouleverse les équilibres au travail, avec un accroissement mécanique du risque d’usure professionnelle, surtout dans les métiers pénibles.
- La montée des attentes individuelles, en matière de flexibilité, de personnalisation des parcours ou de reconnaissance des situations particulières, s’accompagne d’un risque de dilution du collectif. La cohésion d’équipe, l’équité et la solidarité restent pourtant des piliers de la prévention de l’absentéisme.
- La complexification des organisations et la multiplication des transformations, qu’il s’agisse de digitalisation, de réorganisations ou de nouveaux modes de travail, génèrent une instabilité qui peut entraîner fatigue, perte de sens, réduction de l’autonomie et désengagement propice à l’absentéisme. Il est alors crucial de mener des audits d’impact humain avant chaque transformation majeure, d’évaluer la charge d’adaptation, d’instaurer des espaces d’expression des inquiétudes et d’accompagner les managers de proximité
Conclusion : L’absentéisme, révélateur et levier de transformation
L’absentéisme, loin d’être une fatalité, est un révélateur des défis sociaux, sanitaires et managériaux du monde du travail français. Il impose une mobilisation collective : politiques de santé au travail ambitieuses, médecine du travail renforcée, dialogue social vivant, managers outillés et salariés acteurs de leur santé. En s’inspirant des meilleures pratiques européennes, en adaptant les réponses aux spécificités françaises et en hiérarchisant les priorités à partir d’une analyse fine des données RH, chaque organisation peut transformer ce défi en opportunité pour développer engagement et performance durable.
Le rapport complet du Cercle est disponible sur demande
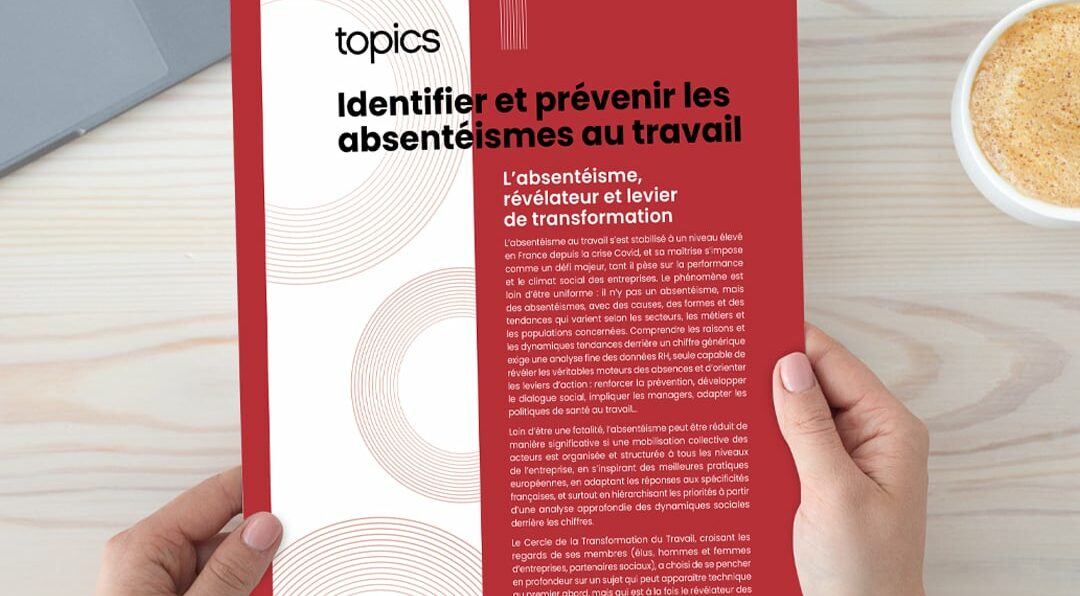
À propos du Cercle de la Transformation du Travail :
Créé en octobre 2023 par Bruno Mettling, Président de topics, le Cercle de la Transformation du Travail a pour ambition de poser un regard prospectif et structurant sur les grandes questions qui ont un impact sur l’organisation du travail avec un triple angle de vue : travail – emploi – compétences. Cette recherche de pluralisme dans l’approche, le Cercle l’aborde aussi à travers ses membres : des acteurs politiques (Xavier Bertrand et Stanislas Guerini, anciens ministres), des partenaires sociaux (Laurent Mahieu, ex-Secrétaire Général UCC Cadres CFDT, Florence Poivey, Présidente de WorldSkills France, ex-Présidente de la fédération de la plasturgie, Guillaume Trichard, Secrétaire général adjoint Unsa) et DRH de grandes entreprises (Valérie Decaux, Groupe La Poste, Jean-Sébastien Blanc, Engie, Jean-Manuel Soussan, Groupe Bouygues, Stéphane Dubois, Safran) et pour topics Bruno Mettling, Marc Grosser et Fanny Barbier.